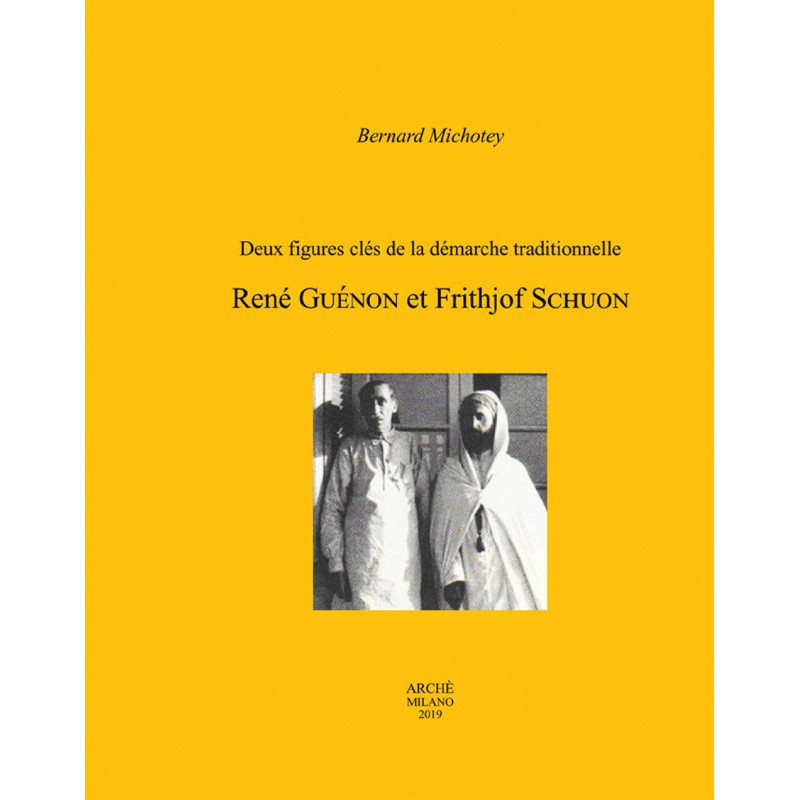
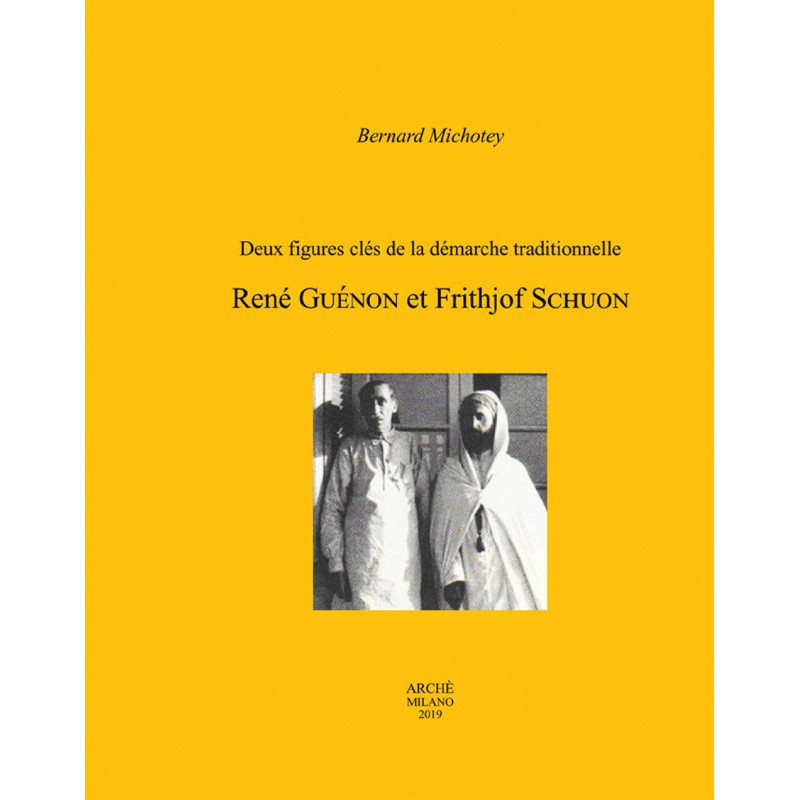
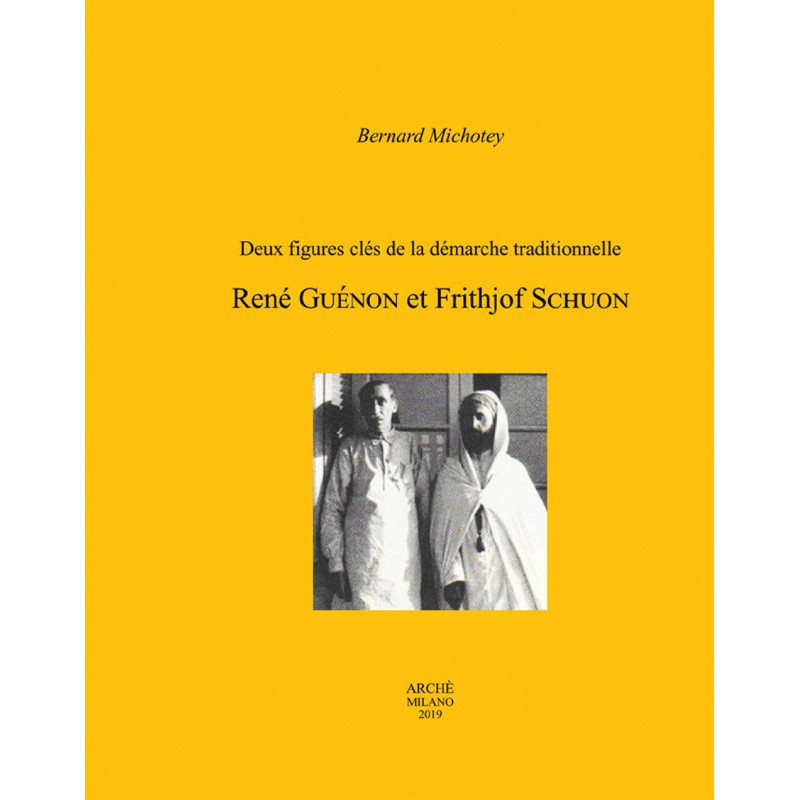
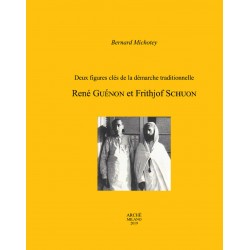
Les textes présentés ici évoquent le message de R. Guénon et de F. Schuon: celui de deux grandes figures d’un courant d’idées que l’on a souvent appelé «la pensée traditionnelle» ou «l’école traditionnelle». À première vue, une telle pensée entendait s’opposer à la «pensée moderne» et elle pouvait ainsi paraître viser une reprise ou un prolongement du propos de multiples représentations du «traditionalisme» ou de «l’antimodernité». Toutefois, la référence de ses promoteurs à la notion de «tradition» traduisait une orientation assez spécifique et inédite...
Les textes présentés ici évoquent le message de R. Guénon et de F. Schuon: celui de deux grandes figures d’un courant d’idées que l’on a souvent appelé «la pensée traditionnelle» ou «l’école traditionnelle». À première vue, une telle pensée entendait s’opposer à la «pensée moderne» et elle pouvait ainsi paraître viser une reprise ou un prolongement du propos de multiples représentations du «traditionalisme» ou de «l’antimodernité». Toutefois, la référence de ses promoteurs à la notion de «tradition» traduisait une orientation assez spécifique et inédite. La réthorique, apparemment assez «réactionnaire», de Guénon et la réthorique plutôt «conservatrice» de Schuon n’avaient pas l’ambition de s’inscrire dans l’économie générale de la pensée occidentale moderne. Elles se référaient à l’ «Orient», au «Moyen-Âge» à la «tradition primordiale», ou encore à ce que Schuon appelait «l’ésotérisme pur» ou «absolu». Elles étaient censées préparer le terrain à la découverte d’un «progressisme» au plus haut point ambitieux: fondé sur l’idée de dépassement souhaitable d’une idéologie occidentale valorisant les performances, passées et à venir, d’une dialectique de l’ancien et du nouveau qui serait affectée à un processus d’innovation.
Fiche technique